[ad_1]
Ce document présente la synthèse et les perspectives des travaux du groupe d’experts des États-Unis d’Amérique.Insérer Le cadre de la procédure d’expertise collective est destiné à répondre à la demande du ministère de la Défense et à prendre en compte les connaissances sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires en France et sur la population polynésienne.
Ces travaux s’adressent essentiellement aux thématiques de recherche de la littérature scientifique disponibles pour le premier semestre 2019. 1 200 documents ont été compilés dans le cadre de l’étude de différentes bases de recherche (Pubmed, Web of Sciences, Scopus). , INIS IAEA1, socINDEX, Cairn, Pascal, Francis, Econbizz, JSTOR, OpenEdition Journals, Isidore, Persée).
Le Centre de compétences collectives Inserm est affilié à l’Institut Thématique de Santé Publique et assure la coordination de cette expertise.
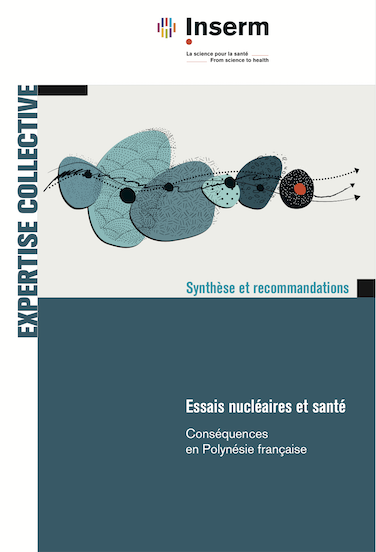
Depuis des décennies, la question des conséquences sanitaires des essais nucléaires effectués par les bailleurs de fonds se pose dans un monde où la situation des droits de l’homme se concentre sur les sites de population exposés et les personnels civils et militaires dans la réalisation de ces essais ; Cette question récurrente pourrait être due à d’autres problématiques de santé environnementale et soupçonnée d’être plus difficile à mettre en place.
Entre 1966 et 1996, la France a entrepris 193 essais nucléaires en Polynésie française, immédiatement après au Sahara, avec le soutien de la logistique du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) : 46 essais sur l’atmosphère ont été publiés durant cette période 1966 – 1974 sur l’atoll de Moruroa et l’atoll de Fangataufa, avec 147 textes sudistes disséminés entre les côtes et lagons des mêmes atolls durant la période 1975 à 1996. Au-delà de leur impact politique, ces essais nucléaires visent à vérifier le bon fonctionnement et la sécurité des armes, à tester de nouvelles formules et à valider la connaissance du corps nucléaire.
Une installation de systèmes de surveillance radiologique de l’environnement en Polynésie créée en 1962. Cependant, des publications scientifiques sont disponibles concernant les niveaux d’exposition aux matières radioactives et les effets à long terme de ces investigations nucléaires. Notamment sur la santé de la population polynésienne et des personnels civils et militaires âgés. Le contexte socio-politique lié à la question des conséquences sanitaires des essais nucléaires est fortement marqué par les controverses de la vie, mais aussi par l’évolution de l’ordonnance d’indemnisation sur le site de la Loi Morin et par les travaux de la Commission loi Égalité. Réelle Outre-mer.
Le Ministère de la Défense, par l’intermédiaire de l’Observatoire des Anciens Combattants (OSV), a pour objectif de faire connaître à l’échelle internationale les connaissances scientifiques sur les conséquences des soins de santé nucléaires pour la population polynésienne. Ce problème est très bien documenté dans la littérature scientifique et a identifié des comparateurs possibles. La recherche de données bibliographiques se limite aux publications dont l’impact sur la recherche nucléaire en santé est largement diffusé par d’autres pays (Université, Royaume-Uni, ex-Union soviétique) dans d’autres zones (Iles Marshall, Nevada, Kazakhstan…), ainsi qu’aux publications à d’autres types d’expositions sur les rayonnements ionisants (bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, accidents nucléaires, travailleurs de l’industrie nucléaire, exposition à des fins médicales).
Il s’agit d’un groupe de 10 experts pluridisciplinaires dans les domaines de l’épidémiologie, de la santé publique, de la sociologie, de la dosimologie, de la biologie cellulaire et moléculaire. S’agissant d’un fonds documentaire composé de plus de 1 200 articles scientifiques, rapports et documents institutionnels, il n’analyse pas les filières qui conduisent à un nombre précis de statistiques. L’analyse relationnelle est structurée en quatre partis : Le parti unique en Polynésie française (contexte socio-politique, services de veille sanitaire, représentation des résidus de population dans les conflits nucléaires) ; La seconde partie analyse les données épidémiologiques et les conséquences des études sanitaires des essais atmosphériques de bombes atomiques pour les études menées par la France en Polynésie et en Polynésie française et pour les essais réalisés par d’autres pays sur différents sites dans le monde. La partie III examine les effets potentiels de l’exposition préconceptionnelle ou in utero aux rayonnements inhérents aux humains et aux animaux ; Enfin, la Partie IV se caractérise par les connaissances élémentaires et la capacité fondamentale à enrichir la réflexion sur la problématique des conséquences sanitaires, notamment avec les approches de reconstruction dosée et les mécanismes biologiques qui y sont associés. Il n’est pas essentiel que l’équipe d’experts soit spécifiquement spécialisée dans les effets des rayonnements ionisants et n’ait pas de problèmes avec d’autres effets sur la santé, par exemple les maladies nucléaires (effets psychologiques, toxicité chimique). de radionucléides, etc.).
L’analyse du groupe d’experts a été enrichie par les interrogatoires de professionnels qui ne sont pas sûrs de ne pas adhérer aux communications écrites des contributions à la conclusion du rapport d’expertise et par l’éclairage du point de vue des associations de victimes. Essais sur l’énergie nucléaire dans le métropole et en Polynésie en France. La synthèse des différents constats réalisés par les experts permet de formuler des perspectives de recherche, de surveillance sanitaire et de voile scientifique pour la Polynésie française.
Bénéficiez de l’expertise complète
Vidéos de présentation :
Téléchargez l’expertise
[ad_2]
Source
